Les étiquettes
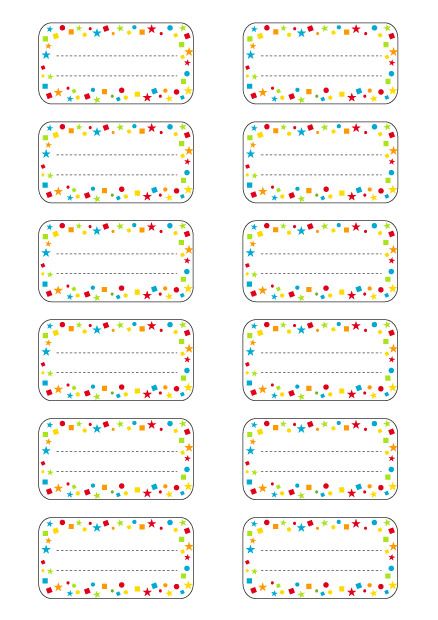
Je n’ai jamais été douée pour les relations sociales. Depuis la maternelle je le ressens mais au début je ne comprends pas. Je n’ai pas suffisamment de recul ni de maturité pour le comprendre. J’ai réalisé qu’à l’aube de mes 18 ans qu’en réalité je suis tout simplement une personne différente, disons originale ça sonne davantage mieux dans mon esprit.
Cette originalité fait que depuis la maternelle je suis en décalage avec les gens de mon âge. L’élément déclencheur est la phrase d’un de mes colocataires lors du trajet retour d’une excursion à la plage. Ça fait deux semaines qu’on habite dans la même colocation donc pour apprendre à se connaître, on s’est dit que faire des sorties ensemble serait une bonne idée. On est donc dans la voiture d’Éloïse, elle conduit et je suis installée derrière elle. À l’avant il y a Moumen, derrière lui se trouve Margaux. Elle a un mois de moins que moi. Une musique qu’Éloïse aime beaucoup passe à la radio donc elle monte le son et se met à danser. Moumen la suit dans son délire, ils gigotent plus qu’ils ne dansent c’est assez drôle à voir. Moumen s’interrompt et se retourne vers Margaux et moi et dit que c’est comme ça qu’on danse en boîte et qu’on va découvrir ça plus tard. Je lui réponds en riant que je le sais. Il me regarde étrangement et me dit intrigué « Mais t’as pas 18 ans toi ?! ». Je lui explique donc ma ruse avec ma carte étudiante que j’avais modifiée pour être née un an plus tôt. Il souffle un rire et dit « Mais toi t’es qui en fait ? Une intello, une sportive ou une délinquante ? T’es pas normale, tu caches bien ton jeu. Je t’aime bien ». Je
ne me souviens pas de ma réponse. Mon esprit garde seulement l’épisode jusqu’à ce questionnement car il m’a marqué. C’est pas la première fois qu’on me dit que je suis pas normale mais c’est la première fois qu’on me le dit comme si c’était un compliment.
Je repense souvent à cette trilogie d’étiquettes qu’il me colle. Ce sont différents traits de personnalités qui ont été plus ou moins fort depuis le début de ma vie et qui sont
toujours en moi. En revanche, ce qui est constant dans ce qu’il m’a dit, c’est que je ne semble pas normale. Vivant seule à Brest, je suis souvent seule et j’ai donc le temps de réfléchir à ça. Cette réflexion aboutit à une conclusion : je suis en décalage, pas en décalage avec la société mais avec les gens de mon âge. Maintenant que je réalise ce décalage, je revois ma vie différemment. Je revois tous ces souvenirs où je ne me sens pas à ma place, seule, bizarre, anormale ou inutile depuis la maternelle sous un autre angle. Je revois toutes les étiquettes qu’on m’a mises au fil du temps et j’essaye de comprendre.
Dès la maternelle, je me sens seule et pas à ma place parce que je n’ai pas d’amis avec qui jouer à la récréation. Ou du moins je joue de temps en temps avec un autre enfant du village qui va chez la même nourrice que moi. Il y a trois autres filles de mon âge : Laurine, Sophie et Gwenaëlle. Je ne saurai pas dire pourquoi mais elles jouent ensemble alors que moi non. Cela vient sûrement du fait qu’avant la maternelle je me suis toujours cachée derrière mon grand frère et je ne parle pas beaucoup. Maxime parle, j’observe, j’écoute et je suis. Je n’ai pas le réflexe d’aller vers les autres et je ne sais pas non plus comment faire. La seconde hypothèse est que les autres enfants de mon âge me trouvent bizarre. Maman me parle anglais depuis que je suis née alors à la rentrée en maternelle des mots anglais se mêlent à mon français bien que je parle et comprends le français. Peut-être qu’elles trouvent Maman bizarre car elles ne la comprennent pas et donc en concluent que je suis bizarre aussi. Je passe donc beaucoup de temps seule, à l’écart des
autres et j’attends que le temps passe. Je me souviens aussi d’une fin de journée à la garderie, je dois avoir quatre ou cinq ans parce que je vois encore la tapisserie verte et hideuse de l’ancienne garderie alors que la nouvelle école ouvre l’année de mes six ans. Ce soir-là, on me fait comprendre que je n’’ai pas les bonnes préoccupations. Comme je ne joue pas avec les enfants, je reste avec les ATSEM. Je me souviens d’un soir où on voyait le soleil se coucher. Je suis assise à une
table à côté de l’ATSEM et je regarde le jour décliner. Je me rappelle avoir dit à l’ATSEM que ce n’est pas vrai quand on dit que le soleil va au lit parce que c’est une boule de feu et que la terre exploserait s’il allait au lit et qu’on mourrait tous. Elle me répond que c’est vrai mais que je dois penser à autre chose et que je ferai mieux de jouer avec les enfants de mon âge. Je ne pense pas que je suis allée jouer avec les enfants, je suis plutôt du genre à bouder ou pleurer dans un coin parce que je me sens rejetée.
Je suis bien mieux chez moi, je peux dire ce que je veux, jouer avec mon grand-frère, avec ma petite sœur Elsa, ou mon chien. N’ayant pas d’amis avec qui bavarder en classe je mets mon énergie à réussir les activités. Dès la grande section je termine toujours les exercices en première, j’en fais plus que les autres et je les réussis tous. Je m’ennuie. Je crois que les filles n’aiment pas ça parce que lorsque je réponds à toutes les questions que la maîtresse pose, elles soupirent ou lèvent
les yeux au ciel. J’ai le souvenir qu’en CP Elsa fait son entrée à la maternelle. Les premiers jours elle reste un peu avec moi mais étant très sociable elle se trouve rapidement des amis avec qui passer le temps. Maxime me propose occasionnellement de jouer avec lui et ses copains. Petite, j’ai beaucoup admiré mon frère car c’est le garçon populaire qui a des amoureuses et plein d’amis. Tous les autres enfants le respectent alors dès qu’il m’intègre à son groupe social je fais tout pour ne pas le décevoir ni lui faire honte. Ceci fait que je m’efforce de gagner aux différents jeux de cours de récréation : on a une grande collection de billes, de pogs et de cartes Pokémons.
Au centre de loisirs, pendant les vacances c’est la même chose. Je ne me fais pas d’amis. Est-ce moi qui trouve les enfants inintéressants ou eux qui me rejettent, je n’en sais rien. Probablement les deux. Toujours est-il que j’observe et j’attends que passe le temps ou alors je discute avec les animateurs. Les enfants des amis de mes parents qui ont plus ou moins mon âge ne m’intéressent pas non plus. J’essaie de jouer avec les plus grands mais il y a toujours un moment où les grands ne jouent pas avec les petits. Ce que je fais pour m’occuper dans ces cas-là, c’est
que je retourne à table, sur les genoux de mes parents s’ils veulent bien, et j’écoute les conversations. Ou alors, quand il y a des animaux je les caresse et joue avec eux. J’adore les animaux, surtout les chiens. En même temps, je fais de la gymnastique. C’est un sport individuel, ça me convient bien.
Je ne suis pas obligée de me faire des amies pour réussir et m’épanouir. J’apprends à ne plus être maladroite et à maîtriser mes gestes. Je discipline mon corps. Je développe aussi mon côté tenace, je ne change pas d’exercice tant que je n’y arrive pas. Cette détermination m’a réussi en individuel mais aussi en collectif. Au fil des années, je suis intégrée dans un groupe de trois filles à la gym. Seulement, je ne me sens pas complètement à l’aise. Elles sont toutes les trois dans la même école et je sens que je loupe des trucs même si on passe pas mal de temps ensemble. Elles aussi sont fortes. La coach nous prend sous son aile et est plus exigeante avec nous. J’adore ça.
En avançant dans mes années de primaire, je commence à avoir des amis avec qui jouer de temps en temps à la récréation mais il s’agit principalement de garçons. Je suis la seule fille qui aime jouer à la course et qui a l’esprit de compétition. Les filles me regardent de travers parce que je joue avec leurs amoureux. Je me souviens que ce qui m’a permis d’accéder au groupe des filles est qu’un jour un garçon m’a demandé d’aller demander à Laurine si elle veut bien être son amoureuse. Dans mes souvenirs, après cet évènement, je ne suis plus seule pour les récréations. Enfin il y a bien des jours où les filles me font la tête, c’est quand même souvent mais uniquement passager.
À partir du moment où j’ai des amis, je ne suis plus la première de la classe largement en tête, nous sommes deux quasiment exæquo. Les cours m’intéressent de moins en moins. J’aime de moins en moins l’école, je m’y ennuie, je ne veux plus y aller. Parfois sur le chemin de l’école je cache mon cartable dans les buissons pour ne pas arriver à l’école à l’heure ou alors je fais exprès de l’oublier à la maison. Je me fais souvent gronder parce que Maman ne comprend pas pourquoi je fais ça. Pourtant j’explique que je n’aime pas l’école ! Ça Papa le comprend parce que lui aussi n’aimait pas l’école. En CM1, je ne supporte plus l’école. Ça se manifeste par beaucoup de pleurs, de tristesse et de fortes migraines. Mes parents me prennent des rendez-vous avec la psychologue scolaire et à l’issue de ces rendez-vous on me dit que je saute une classe. Je vais finir les deux derniers mois de l’année en CM2 et après j’irai directement en sixième. À cause de mon saut de classe, ou de leur jalousie, mes amies ne veulent plus de moi : retour à la case départ.
Mes psychologues et les livres que mes parents me donnent essayent de m’expliquer ce qui m’arrive avec plein de mots différents. On me dit que je suis une enfant indigo, un zèbre ou encore un haut potentiel intellectuel. Tous ont l’air de dire que j’ai beaucoup de chance, moi j’y vois un handicap parce que je suis différente des autres et donc ils ne m’acceptent pas. Ou alors mon cerveau ne fonctionne pas de la même façon que les autres donc je n’ai pas les mêmes réflexes et réactions que les autres. On me dit aussi que je suis plus sensible que les autres. On me dit que c’est normal que j’aie du mal à me faire des amis. On me dit beaucoup de choses mais ce que je vis je ne le retrouve pas dans leurs mots. Je n’y vois que des inconvénients et je me sens condamnée à ne jamais être comme les autres, à être seule.
Une de mes psychologues avance l’hypothèse que si je suis comme ça c’est en partie
parce que Maman m’éduque en me parlant anglais depuis que je suis née et donc mon cerveau s’est développé différemment à cause de cette éducation bilingue. Je crois que sur le moment j’en veux à Maman. Avec du recul, je me dis que ce n’est pas uniquement ce facteur qui a joué car Maxime et Elsa ne sont pas aussi handicapés que moi alors qu’on grandit dans les mêmes conditions. J’y vois une fatalité, il y a quelque chose qui cloche en moi.
Les vacances d’été arrivent et Max me prépare au collège. Mes parents décident de
m’inscrire dans le même collège que lui et dans l’option bilingue anglais-allemand,
exactement comme Maxime. Il me raconte le fonctionnement du collège et m’apprend quelques mots en allemand. Étonnamment, je ne me souviens pas avoir stressé tout l’été alors que dans mon souvenir je suis une enfant très angoissée à 9 ans. Peut-être que mon cerveau préfère se souvenir que mon grand-frère s’est occupé de moi, que j’ai passé un bel été en famille, là où j’ai une place. Je crois que quelques jours avant la rentrée je suis partie du principe que j’allais avoir du
mal à me faire des amies. Je me souviens m’être sentie en danger ou plutôt comme une cible potentielle. Je connais le cliché de la personne qui n’a pas d’amis et qui est le souffre-douleur. Rajoutons à cela l’étiquette intello, ça faisait beaucoup de chance que je sois l’incarnation de ce cliché. Le premier jour, ou le deuxième, ou du moins au cours de la première semaine de cours, je me rappelle être assise seule sur un banc à profiter du soleil de septembre. Sur le banc d’à côté il y a des gars de troisièmes. L’un d’eux s’assoit à l’autre extrémité du banc où je suis assise.. Je sens qu’il me regarde mais je ne bouge pas pour autant. Ensuite il s’amuse à faire osciller le banc, visiblement il sait que ce banc a une faille. Ne comprenant pas ce qu’il cherche à faire je le regarde, je ne sais plus si je lui dis quelque chose, mais je le regarde avec indifférence et lassitude. D’après Maman, je n’ai pas le regard aimable donc j’imagine que je ne l’ai pas regardé très gentiment. Je vois sur son visage qu’il se sent bête, il se lève et retourne sur le banc avec ses amis qui rient de lui. Ça ne fait même pas une semaine et les plus grands cherchent déjà à m’embêter. Il
ne faut surtout pas que je me laisse faire.
Les garçons de ma classe ont eux aussi cherché à m’embêter en sixième alors dès que je me sens agressée, je distribue des claques. Je sais que la violence n’est pas la meilleure méthode pour se faire respecter mais au moins je ne suis pas le souffre-douleur. Je crois même qu’en fin de compte ils m’apprécient et que les moqueries sont plutôt de la taquinerie, comme mon frère peut le faire. Encore une fois, c’est avec les garçons que je m’entends le mieux. Avec les filles je me sens jugée et je n’ai pas les mêmes centres d’intérêt qu’elles. Je n’en ai rien à faire de savoir ce que Pierre pense de moi ou de la robe que Marie a mise aujourd’hui.
En cinquième, je me retrouve dans la classe de la section sportive de football du collège. Ce sont les petits rigolos qui sont insolents et amusent la galerie en vue de briller auprès des professeurs. Je ne les connais pas vraiment au début d’année, sauf certains de vue parce qu’ils sont dans le même club de foot que Max. Dans le cours de madame Parthenay, on s’est retrouvé dans le même coin et rapidement on se met à faire des bêtises ensemble. On fait aussi de la répartition de révision : chacun un chapitre et on met en commun le jour du devoir. Mais contrairement à eux, je ne suis jamais collée, les profs ne me soupçonnent pas. Je suis la bonne et sage élève qui n’a pas d’amis. J’en ai surement abusé à certains moments. En tout cas, ça m’a permis d’avoir un bon souvenir du collège, au moins de la cinquième.
Les années collèges sont comme un traumatisme. D’abord parce que je suis toujours dans l’ombre de mon frère à tel point qu’on m’appelle « La petite sœur de Maxime G. », le sportif populaire qui sort avec une nouvelle fille dès qu’il est célibataire. Même lorsqu’il entre au lycée certains m’appellent toujours comme ça alors qu’ils me connaissent. Je ne veux pas être sous les projecteurs comme lui, juste qu’on m’appelle Justine simplement parce que je m’appelle comme ça et que j’existe. Des fois, je me dis heureusement que mes parents ne m’ont pas fait sauter une deuxième classe parce que je me serais retrouvée dans la même que lui au vu des options qu’on a et j’aurais dû subir son ombre vraiment toute la journée.
La deuxième raison pour laquelle je n’aime vraiment pas le collège est que les filles sont constamment en train de faire des histoires pour tout et pour rien. Je ne me fais pas de vrais amis. Enfin si, il y a deux personnes avec qui je m’entends bien mais c’est pareil, il y a toujours des moments où ils font la tête. Je me sens rejetée ou du moins pas intégrée, je n’y arrive pas. Je suis proche de certaines personnes à des moments mais je ne sais pas, je ne me sens pas complètement à ma place et puis je ne suis pas Justine, je suis la petite sœur de Maxime G. Je laisse sûrement trop d’importance à cette étiquette, peut-être que ça fait que je pars du principe qu’on ne s’intéresse pas à moi et donc je rejette les gens. Peut-être que finalement, ce ne sont pas eux qui me rejettent mais l’inverse, je ne m’intéresse probablement pas assez à eux. Mais c’est que je me sens bizarre, parce qu’ils me font sentir bizarre. Je sens que le problème vient de moi, de ce que je suis et je ne vois pas comment changer. Je suis bloquée avec moi. Je crois que je ne m’aime pas vraiment à cette époque de ma vie et je me sens très seule. Je suis “la petite sœur de”, “l’intello”, l”a
fille qui est tout le temps toute seule”. C’est ainsi que je me sens perçue, ce sont mes étiquettes et je n’aime pas ça, donc je ne m’aime pas.
Le lycée arrive comme une délivrance. Je suis prise dans le lycée que je veux avec l’option que je veux, en internat, dans un autre établissement que celui de mon frère et où il n’y a que trois ou quatre personnes de mon collège. Je suis libérée de toutes les étiquettes. Mais le lycée a ses étiquettes à lui. Il est réputé pour être le lycée « des L » car tous les gens qui y sont « ont un style de L » d’après les autres lycéens d’Angers. C’est-à-dire que les gens pensent que tous les lycéens sont drogués, tatoués, percés de partout, ont des dreadlocks ou les cheveux teints et portent des sarouels. Moi, je vois ce lycée comme un lieu où on peut être ce qu’on veut sans être jugé. Et donc, oui, forcément il y a des adolescents avec des styles, disons non conventionnels, mais personne n’en a rien à faire.
Dès le premier jour, je trouve mon acolyte de mes années lycées, celle avec qui je suis en classe et à l’internat. Je trouve aussi mon noyau dur, mes trois meilleurs amis, ceux qui sont toujours là. Je m’entends bien avec beaucoup de gens de ma classe, ça aussi c’est nouveau. Je me sens plus libre d’être moi. Même si un jour on m’a montré une photo Instagram d’un garçon en me disant « avoue il est BG » et que je n’ai pas pu répondre objectivement car il s’agissait de mon frère, son ombre ne pèse pas trop sur moi. J’ai réellement l’impression d’être libérée d’un poids et j’apprends à m’accepter et même à m’aimer. C’est encore plus simple avec mes amis. On est tous pareil, un peu perchés, un peu intello et pas en phase avec les gens de notre âge. Je ne suis pas la seule à être comme je suis et je n’ai pas d’étiquette collée au front. En revanche, dès que j’en sors, j’ai l’étiquette « Joach’ ». Mais je n’en ai rien à faire, dans mon lycée on apprend à ne pas lire
les étiquettes, à les ignorer.
Je trouve enfin l’épanouissement en milieu scolaire mais je perds celui que j’ai à la
maison. Mes parents se séparent quelques mois après mon entrée en seconde. Je ne
m’entends plus avec Maxime et de moins en moins avec Elsa. Maman est partie de la
maison, je ne la vois que sur les trajets maison-lycée et le dimanche. Papa s’effondre, je ne le vois que le samedi. En première et terminale, je retrouve plus ou moins mes parents, bien que rien ne soit plus pareil. Ma fratrie est abandonnée et comme si on avait pas assez mal, on se donne des coups entre nous. Je perds la place que j’avais dans la famille. On est plus en phase entre nous. Maintenant c’est ma fratrie qui me met des étiquettes. À présent je suis perchée et bizarre car je ne suis pas comme eux : j’aime lire et j’aime les légumes. Avec du recul je trouve que c’est vraiment bête de discriminer quelqu’un pour ces motifs mais sur le moment je me sens terriblement mal de ne plus être inclue à ma fratrie. Je me sens triste, blessée et en colère de ne pas pouvoir être moi au sein de ma famille sans me faire juger. Je suis bien contente d’être à l’internat, la semaine je n’ai pas à les supporter.
La fin du lycée arrive. Les choix d’orientation se font. En septembre, je me retrouve à faire une licence de tourisme et loisirs. Je ne suis qu’à moitié convaincue de mon choix. Il y a quelques cours qui me plaisent mais ce n’est pas suffisant, je ne sais pas encore exactement ce qu’il me faut mais je sais que ce n’est pas ça. Je crois que si je n’aime pas mon entrée dans le supérieur c’est en partie parce que je suis sortie de ma bulle lycéenne où il n’y a pas de jugement. En arrivant à la fac, j’ai l’impression de me retrouver dans la cour du collège avec toutes ces hyènes. Je me sens vraiment agressée par tous ces regards que je ne subissais plus depuis trois ans où j’ai pu reprendre confiance en moi et apprendre à m’aimer à nouveau. Ces regards remettent en question toutes ces avancées personnelles. Je me sens de nouveau différente et bizarre. Rebonjour les étiquettes.
Le souvenir qui me marque le plus est lorsqu’au premier cours d’allemand on doit se
présenter devant toute la classe. Je commence donc par mon prénom et nom puis mon âge. Lorsque je dis que j’ai 16 ans, je vois des gens me regarder avec incompréhension et je ressens du jugement, quelque chose de malveillant. Je l’interprète comme un « qu’est ce qu’elle fait là cette gamine ». Cette situation commence à me rendre malade, je quitte la licence mi-octobre et j’intègre
Rebond’sup, le dispositif de réorientation de l’Université d’Angers. Là-bas, je rencontre des gens tout aussi perdus que moi. Je me sens libérée du poids de devoir assumer des études où je ne m’épanouis pas pleinement. Je sens la possibilité d’être moi-même, je me fais des amis. Le dispositif ne nous occupe que quelques heures dans la journée donc on a le temps de sortir. On le fait beaucoup d’ailleurs, généralement du mardi soir au jeudi soir pour moi car je rentre dans ma famille dès le vendredi soir mais les autres continuent jusqu’au samedi soir. Je suis le rythme, je m’amuse. Je ne pense pas trop à l’après Rebond’sup pour l’instant. Je profite de l’insouciance de mes 17 ans.
À cette même rentrée, Maxime s’envole pour les États-Unis. Il me dit que maintenant je suis la grande, je suis le modèle pour Elsa. Sauf que moi, j’ai pas ce caractère-là,
l’étiquette grande sœur modèle je n’y adhère pas du tout. La preuve est qu’il m’envoie des messages pour me dire de mieux me comporter, je l’envoie balader. Je suis alors la sœur rebelle. En parallèle, je reprends le sport en club. Je suis dans l’équipe de foot de U18 de mon club. Je joue avec Elsa et Papa est le coach adjoint. C’est vraiment génial, je m’amuse et refaire du sport me fait du bien. Sur le terrain je me sens intégrée, je suis dans l’équipe. En dehors, c’est une autre histoire. Le groupe comprend des filles âgées de 14 à 17 ans et je ne suis pas vraiment à l’aise avec les gens de mon âge. Je ne sais pas comment trouver ma place d’autant plus que beaucoup des filles sont les amies de ma sœur. Je ne veux pas déranger Elsa dans sa vie alors je préfère rester en retrait, je m’efface. Le décalage est d’autant plus évident lorsqu’on se rend compte que certaines sont encore en troisième et que moi je viens de rentrer à l’université et que je suis en soirée presque toute la semaine. On n’en est pas aux mêmes étapes de la vie.
Je me sens heureuse même si je sais que je me voile la face, j’aime l’insouciance qui
m’habite. Je me sens libre et tellement légère que je m’envole. Mais comme Icare, je
m’envole trop haut et me brûle les ailes. Ma période d’insouciance s’envole au moment même où mon ligament se déchire et que je m’écroule sur le terrain de foot. J’ai 17 ans, un genou cassé et je ne sais pas comment m’imaginer dans le futur. Je suis brusquement ramenée sur terre pour un combat de plusieurs mois. Les premières semaines je suis incapable de rester debout ou de rester assise plus de
quelques heures. Je suis bien, ou presque, uniquement lorsque ma jambe est surélevée et glacée. On me surnomme l’estropiée et l’handicapée à la maison. Maman dit que c’est bien fait pour moi, je n’avais qu’à ne pas faire de football. Maxime qui rentre des États-Unis se moque de moi. J’agace ma fratrie parce que ça empêche des sorties, parce que je ralentis le groupe peut-être aussi parce que j’attire l’attention. Je me retrouve dans une bulle à côté du monde qui m’entoure. Mes amis de Rebond’sup continuent à sortir et faire des activités tout en continuant à être insouciants. Mon noyau dur fait des fêtes d’anniversaires et fêtent le nouvel an sans moi. Ma famille continue à faire du sport sans moi. Je me sens exclue et je ne me supporte pas pendant les trois premières semaines.
Ce sentiment d’exclusion diminue quelque peu lorsque je recommence à marcher mais pendant cinq mois je n’ai plus confiance en mon genou, l’articulation qui représente la stabilité du corps. Intérieurement je rejette la faute sur Papa, comme si une malédiction pesait sur lui et sa descendance parce que je me casse le genou au même âge que lui. Je me laisse aller, perdue entre la colère, la tristesse et la douleur. Je n’ai plus une montagne à gravir mais deux. Ou plutôt, la montagne est devenue beaucoup plus raide et a doublé de taille et ce n’est déjà pas facile quand on a la tête déséquilibrée alors quand tout le corps l’est, ça paraît insurmontable. Le fait de ne plus avoir le groupe Rebond’sup, dans le sens où je ne fais plus de sorties
avec mes amis, fait que je ressens à nouveau ces sentiments de solitude, d’isolement et d’errance qui avaient disparu quand j’avais rejoint le dispositif. Pour occuper mes journées et dissiper le sentiment d’errance, je cherche un avenir.
Chercher un avenir c’est une introspection. C’est se poser beaucoup de questions sur soi, des questions qu’on ne veut pas se poser parce qu’elles font mal ou sont dérangeantes. Comme en janvier mes deux seules activités de la semaine sont les ateliers Rebond’sup et le kiné, j’ai le temps de répondre à ces questions ou du moins de tenter d’y répondre. Je n’ai que des réponses partielles.
Qui suis-je ? Je suis une adolescente perdue et cassée.
Qu’est-ce que j’aime ? L’indépendance, le sport et mes amis.
Qu’est-ce que je n’aime pas ? Ma famille et moi.
Qu’est-ce que je souhaite ? Me rétablir, pouvoir marcher, être heureuse, partir loin de ma famille.
Qu’est-ce que j’ai fait de ma vie jusqu’à maintenant ? J’ai le sentiment de n’avoir rien
accompli.
Quels sont mes points forts ? Bonne question.
Quels sont mes points faibles ? Je suis entièrement faible.
Qu’est-ce que je souhaite pour moi dans mon futur ? Je n’en sais rien.
En février, je ne supporte plus ma lassitude et cette position de victime qui me met en position de faiblesse face à ma fratrie. J’en ai marre d’être appelée l’handicapée. Je retrouve, enfouie au fin fond de moi, ma détermination, celle que j’avais avant mes 10 ans. Je me reprends en main : j’ai une montagne très haute et très raide à gravir. Je reprends sérieusement les questions des ateliers Rebond’sup. J’en conclus que je me sens ignare donc je décide de postuler à une licence qui va me cultiver et en bonus loin de ma famille. Ma conseillère d’orientation me dit de faire un parcours de langues parce que je suis quasiment bilingue. Je ne vois pas l’intérêt. C’est une compétence acquise ou presque, autant que j’en développe une nouvelle. Je décide alors de lui tenir tête parce que je ne suis plus une victime qui se laisse glisser le long de la montagne. Je suis une combattante qui la gravit. Je ne veux plus l’étiquette d’handicapée mais je veux celles de combattante et de personne autonome.
À la fin du mois de mars, le chirurgien répare mon genou. Je ne sais pas l’expliquer mais je vois ça comme un nouveau départ. En trouvant mon orientation, je suis arrivée à la moitié de ma montagne, maintenant il me reste plus que l’autre moitié. Je suis physiquement réparée et je n’ai qu’une hâte c’est de me remettre en forme le plus vite possible. Bien sûr, les trois premières semaines sont très douloureuses et fatigantes, d’autant plus que je n’ai pas pu avoir mes soins de kinésithérapie tout de suite. Je commence ma convalescence avec du retard mais je le rattrape assez vite. J’avais déjà eu un suivi kinésithérapeutique pour ma scoliose entre mes 10 et 11 ans et j’avais trouvé ça dur, long et douloureux mais ce n’était rien à côté du travail pour rééduquer mon genou. Je suis très émotive, j’ai la larme facile alors cette convalescence est traversée de larmes. D’abord, des larmes de douleur en essayant de réveiller mon quadriceps, lors des soins pour mes cicatrices, après ou pendant les séances de kiné. Des larmes de peur lors de mes premiers sauts à cloche-pied sur ma jambe réparée. Mais surtout des larmes de joie lorsque je peux de nouveau tendre ma jambe, lorsque je prends appui dessus, lorsque je fais mes premiers pas sans béquilles.
Fin juin, j’ai suffisamment travaillé pour pouvoir faire sept kilomètres de vélo, travailler cinq heures dans les champs et rentrer à la maison après sept nouveaux kilomètres de vélo. Je suis assez fière de moi, trois mois auparavant j’étais même pas capable de poser mon pied au sol. Des larmes de joie coulent discrètement le premier jour où je le fais. D’autres larmes de joie coulent environ un mois après lorsque je réussi la première étape de réathlétisation qui consiste en un cycle où je dois courir deux minutes et marcher deux minutes, répété dix fois. Je suis super fière de moi. Je cours en vrai et pas seulement dans mes rêves. Papa est avec moi ce jour-là, c’est lui qui gère le chronomètre. Dans mon souvenir, il me regarde avec beaucoup d’incompréhension lorsque j’arrive vers lui. Je suis en larmes et je répète « J’ai réussi papa ». Il me prend dans ses bras et me dit « oui mais c’est que le début ». Avec du recul ça sonne pas vraiment comme des félicitations mais à cet instant je suis tellement heureuse que j’ignore presque ce qu’il me dit. Au cours de
cette période, je ne me sens absolument pas soutenue par ma fratrie, un peu plus par mes parents mais je ne ressens pas de reconnaissance. Comme si toutes ces étapes, ces petites victoires, ne sont pas extraordinaires mais simplement normales alors que ça ne fait que quatre mois. Papa et Elsa se sont fait la même blessure depuis mon accident et aucun d’eux n’a été capable de faire tout ça quatre mois après l’opération.
L’été se passe et je pars à l’aventure, à Brest. Je rencontre de nouvelles personnes. Le premier semestre de cours est difficile, après deux semaines je veux déjà rentrer en Anjou et changer de licence. J’essaye de me ressaisir. Heureusement que je m’entends super bien avec mes colocs. Moi qui n’étais pas super emballée à l’idée de vivre en colocation, finalement c’est une très bonne chose. On fait des sorties ensemble, on mange très souvent ensemble, on passe nos week-ends ensemble. Ils sont un vrai soutien moral et je garde énormément de bons souvenirs avec eux. C’est d’ailleurs grâce à eux que je réalise que je suis quelqu’un d’atypique et que ce n’est pas une mauvaise chose. J’ai réalisé qu’au fil du temps les gens m’ont collé plein d’étiquettes. Certaines semblent s’opposer mais je sais les concilier parce que c’est ce que je suis. Certaines ont été plus fortes que d’autres à certains moments de ma vie. Au début de ma licence, je crois que je n’ai plus une étiquette qui domine les autres. Je crois que j’ai trouvé l’équilibre entre tous ces traits de personnalité.
Mes trois années de licence sont difficiles. J’ai du mal à être loin de mes proches. J’ai
l’impression que je loupe quelque chose et j’ai peur de perdre les gens que j’aime. C’est en partant de chez moi que je me rends compte de cette peur. Grâce au covid-19, je passe la fin du second semestre confinée avec Martin, mon petit-ami, et presque la totalité de ma deuxième année de licence en Anjou. Je ne me suis pas confinée avec ma famille. C’est trop risqué. Les tensions sont toujours là et déjà qu’être confiné c’est difficile, pas besoin d’ajouter les problèmes familiaux. Malgré tout, j’ai l’impression de m’éloigner de ma famille, de les perdre. Papa dit que je n’ai plus besoin de lui et que j’ai Martin maintenant. Ça me fait mal d’entendre ces mots, ça me rend triste. J’ai besoin de mon papa, je veux pas qu’il me lâche, je veux pas le perdre. Peut-être que l’étiquette “autonome” paraît plus forte qu’elle ne l’est.
La dernière année est la plus compliquée. Comme les marathons, les deux derniers
kilomètres sont les plus difficiles. Dans mon cas, les deux derniers semestres sont les
plus durs. Après un passage à vide qualifié de « burn-out étudiant » par le médecin puis de réaction dépressive par la psychologue, j’essaye de remonter la pente, je retourne chercher l’esprit de combattante que j’ai fait naître lors de ma rééducation du genou. Je décide de faire revenir cette étiquette. Le dernier semestre est plein de stress entre trouver un master, trouver mon emploi estival, trouver un stage, assumer mes emplois étudiants, en parallèle je rénove une maison avec Martin et je fais des aller-retours tous les weekends entre Angers et Brest pour tenir moralement. J’essaie de tout faire en même temps. La vérité c’est que je sature mais il est hors de question d’échouer.
Aujourd’hui, je suis sur la dernière centaine de mètres de ce marathon. C’est une torture mais la fierté de réussir le défi en vaut la chandelle, parait-il. Dans mes moments de doute, Martin est là pour me soutenir. Il me rappelle que je me suis battue pendant presque trois ans et que ce n’est pas à quelques semaines de la ligne d’arrivée que je vais baisser les bras parce que je suis une battante, une guerrière.
En mettant noir sur blanc mes étiquettes, je me demande si on choisit nos étiquettes.
Bien sûr, les étiquettes sont définies par l’attitude qu’on dégage en public, mais si on n’ est pas conscient de notre manière d’être, on ne choisit pas. On ne choisit pas non plus l’interprétation que les autres font de nous-même. Pourtant, j’ai l’impression d’avoir choisi les étiquettes de battante et d’autonome que Maman, Papy, Martin, ma belle-mère ou encore Adèle ont vu en moi. Malgré ça, je reste la sœur perchée, bizarre qu’on ne veut pas vraiment. Finalement, peut-être qu’on ne choisit qu’à moitié nos étiquettes. On décide ce qu’on veut montrer et le monde autour interprète ce qu’il veut.
Justine