|
|
|
|
Pour rejeter la littérature dans l’enfer de la subjectivité, les sciences sociales avaient
quelques bonnes raisons, à côté d’une foule de mauvaises, car le mouvement romantique entraînait, et entraîne toujours, une grande partie de la littérature vers la découverte des profondeurs intérieures, des jeux de miroir du Moi, où la bourgeoisie
triomphante se plaît à errer comme dans les bas-fonds, qui — chacun le sait — n’ont
pas de fond. Mais tout de même : de Charles Dickens à Jack London, d’Honoré de Balzac à Émile Zola, il y avait un trésor d’observations empiriques, et un travail sur les
formes, la description, le dialogue, le monologue intérieur, les arcanes de l’imagination, la contextualisation dans les paysages terrestres autant que sensibles, dont l’alliance constituait et constitue toujours un stock de connaissances injustement oubliées ou rappelées distraitement, rituellement, au passage, comme on donne le coup de pied de l’âne.
Et pourtant restent fréquentées et semblent éternelles des œuvres sociologiques pourtant déjà anciennes qui ne sont pas œuvres de sociologues universitaires, mais de journalistes-sociologues, tels Siegfried Kracauer (2012) ou James Agee et son compère photographe Walker Evans (1939, 1988), de socialistes-sociologues, tels Marie Jahoda et son collègue Hans Zeisel (1932, 2002), de témoins-sociologues tel Louis Calaferte (1956), ou encore Robert Roberts (1971, 1990). La liste ne serait pas si longue mais il est possible de la raccourcir encore en distinguant ce qu’ils ont en commun : pas seulement, comme on le dit souvent, d’avoir donné une dimension universelle au fait singulier qu’ils étudiaient, à l’histoire singulière qu’ils racontaient, mais d’avoir écrit comme des écrivains et, ce faisant, d’avoir rejoint les écrivains de leur époque qui s’attachaient aux mêmes faits.
|
|
|
|
|
Les indispensables
|
|
|
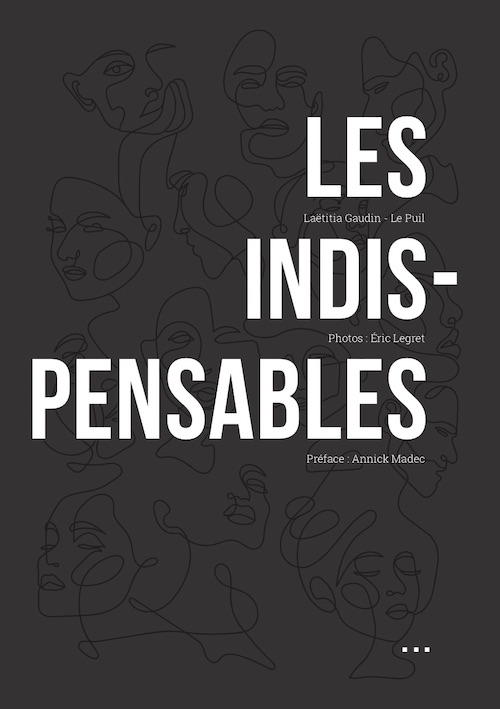
C’était il y a presque un an. Le 17 mars 2020, la France confinée, le reste du monde à l’arrêt aussi. La journaliste et réalisatrice de documentaires Laëtitia Gaudin-Le Puil avait prévu d’être ailleurs, sur le continent africain ; elle sera assignée à résidence, comme d’autres. Elle ne s’en plaint pas. Être confinée à Plouguerneau n’est pas une punition. C’est une chance. Très vite, ce qui aurait dû être un temps pour le grand ménage de printemps s’est mu en un exercice exaltant : recueillir la parole de celles et ceux restés au charbon, « en première ligne ». Le déclic : un échange téléphonique avec un ouvrier d’une « grosse boîte » finistérienne, lequel était devenu, par magie, « indispensable » au bon fonctionnement de l’entreprise. Les cadres et les agents de maîtrise, eux, furent priés de rester chez eux, en télétravail.
|
|
|
|
|
|
|
Exilés : ce qu’habiter àl’hôtel veut dire
|
|
|

Les « hôtels-budget » des années 80 accueillent aujourd’hui des familles entières pour des durées qui peuvent se compter en mois. Qu’est-ce qu’habiter dans ce type d’hôtels, souvent situés à la périphérie des villes, veut dire pour ces familles ? Comment le quotidien et l’attente influent-ils sur les vies, les trajectoires et les représentations ? C’est au partage de cette réalité qu’invite cet ouvrage tiré d’une enquête menée dans 15 hôtels différents. Avec un cahier de photos. Accès gratuit en ligne au texte intégral. http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/exiles-ce-qu-habiter-a-l-hotel-veut-dire-a2160.html
|
|
|
|
|
|
|
LE BUS DES FEMMES. Prostituées : histoire d’une mobilisation
|
|
|
En pleine épidémie de sida, des prostituées interpellent les pouvoirs publics sur leur santé et les conditions d’exercice de leur métier. Leur action, contemporaine de la création d’Act Up-Paris, conduira à la création du Bus des femmes en 1990. Un document historique rarissime qui témoigne de l’histoire des mobilisations citoyennes, un exemple unique de class action chez les prostituées.
|
|
|
|
|
|
|
La Cravate
|
|
|

Dans La Cravate, Étienne Chaillou et Mathias Théry racontent : Bastien Régnier, vingt ans, militant à Amiens du premier parti d’extrême droite ; son histoire, ses espoirs, son action, ses idées, ses réflexions, ses déconvenues… Le film commence. Un fauteuil. Avec à gauche, une table. Sur la table, une lampe et un petit livre : La Cravate. C’est le texte du film, la voix off qui accompagne ses autres images et ses autres voix. C’est aussi le texte que Bastien lit, dans le fauteuil à la lumière de la lampe à côté, et que tout du long il commente, amusé, pensif, surpris, soucieux. C’est encore et enfin le texte, dont avec l’aimable autorisation des auteurs, nous vous livrons quelques extraits... en exclusivité !
|
|
|
Publié dans
Lectures buissonnières
par Un livre de Jean-François Laé et Laetitia Overney aux Editions Bayard
9 décembre 2019
|
|
|
|
|
Johnny, j’peux pas me passer de toi. Ecriture de séparation et de mémoire
|
|
|

Nous le connaissons à peine ; nous l’avons juste entendu régulièrement à la radio, suffisamment pour retenir quelques bribes de refrains. Guère plus. Nous ne savons rien de sa vie, sauf à lire ce qui s’affiche au kiosque. Tout ce que l’on sait vraiment de Johnny Hallyday vient de la Madeleine, où chaque 9 du mois, lors des messes qui sont célébrées à son intention en commémoration de ses obsèques le 9 décembre 2017, une avalanche d’écritures emplit les pages d’un cahier mis à disposition des participants. Avec un extrait et en document joint le compte-rendu du journal Libération.
|
|
|
|
|
|
|
Beauté Parade
|
|
|
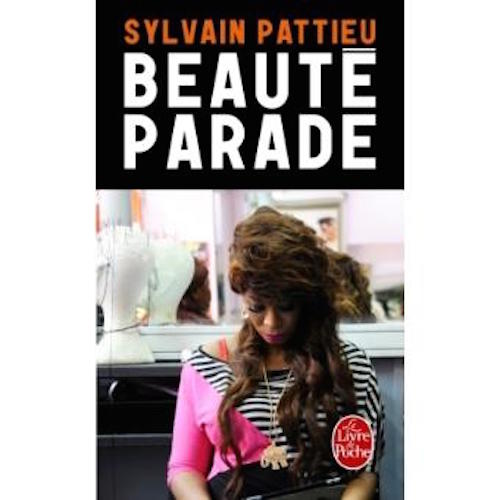
Un jour au quartier populaire de Château rouge à Paris, le patron a quitté le salon de beauté. Alors les femmes ont décidé de continuer sans lui. Elles ont occupé le salon pour s’approprier le travail et pour réclamer des papiers. Des jours et des semaines durant.
Sylvain Pattieu fait la chronique de leur mobilisation à coup de courts chapitres qui se suivent sans se ressembler : parole aux femmes, descriptions – lumière sur le quartier, le salon, les personnes – récits d’ordinaires et d’événements, incursions par l’histoire, la religion, l’économie et même la mythologie. Voici l’un d’entre eux, et puis quelques autres en fichier attaché.
Pattieu Sylvain, 2015, Beauté parade, Le livre de poche.
|
|
|
|
|
|
|
Le vieux. Autobiographie d’un voyou
|
|
|
Le vieux. Autobiographie d’un voyou. Par Azzedine Grimbou et Michel Kokoreff (Editions Amsterdam, Paris 2018). “Je fuguais parfois à Vénissieux, Lyon, toujours avec quelqu’un. On volait une DS 21, une ID, et on partait voler. On était spécialisés. Je faisais des appartements avec un pied de biche ou un briquet. Par un pote qui travaillait à l’usine, on se fabriquait un tournevis, une pince petite comme ça, et on s’est spécialisés". Voir les bonnes feuilles de cet ouvrage (le chapitre 4, "Bien faire sa prison"). Et ci-dessous sa couverture.

|
|
|
|
|
|
|
Incursion dans une étrange forêt
|
|
|
Extrait de l’ouvrage de Claudine Dardy (Editions L’Harmattan, 2018), Exister par écrit. Essai sur l’identification en culture de l’écrit : "Naître et mourir, des événements ordinaires qui s’inscrivent dans des registres officiels. Quelle est la portée pour chacun de nous de cette écriture officielle produite par un système d’Etat Civil ? [Parmi les réponses, voyez] une histoire singulière, celle d’une femme qui refusa de se faire connaître au siècle dernier et qui réussit si bien qu’elle ouvrit à ses fille et petite-fille le champ des possibles, une forme d’état incivil. Celui-là même exercé, comme par ironie, par le peuple grandissant et âgé des troublés de la mémoire et de toutes les filiations".

|
|
|
|
|
|
|
Une fille en correction (Extraits)
|
|
|

Tout débute après la seconde guerre mondiale.
Dès sa naissance en 1946, le tribunal pour enfant d’Avignon suscite une poignée de frêles rapports, souvent quelques lettres, rédigées par la seule assistante sociale rattachée au Palais : Melle Rouvat.
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | |
| |
|
|